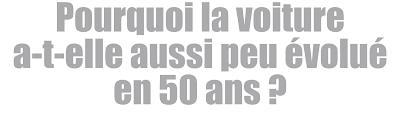Qui aurait cru que le fauteuil roulant pour handicapés ou vieillards impotents devienne un jour un modèle pour penser la mobilité urbaine du futur?
Qui aurait cru que le fauteuil roulant pour handicapés ou vieillards impotents devienne un jour un modèle pour penser la mobilité urbaine du futur?
Et pourtant ...
Aux Etats-Unis, il suffit de se promener à Las Vegas, dans les centres commerciaux ou à Disneyland, pour voir que le fauteuil roulant électrique est devenu un moyen de transport à part entière (notamment pour les obèses !!)
Mais les plus en avance dans cette démarche, sont une nouvelle fois les constructeurs japonais, qui aujourd'hui démultiplient les petits concept-car d'une place.
Cette production se fait sous une double influence.
D'abord celle du vieillissement de la population nippone, et la nécessité de proposer des engins adaptés aux déplacements de proximité, le fauteuil roulant est apparu comme une réponse naturelle. Restait à la caréner autrement. Chose faîte aujourd'hui par la plupart des constructeurs (Honda, Suzuki ...)
Aux Etats-Unis, il suffit de se promener à Las Vegas, dans les centres commerciaux ou à Disneyland, pour voir que le fauteuil roulant électrique est devenu un moyen de transport à part entière (notamment pour les obèses !!)
Mais les plus en avance dans cette démarche, sont une nouvelle fois les constructeurs japonais, qui aujourd'hui démultiplient les petits concept-car d'une place.
Cette production se fait sous une double influence.
D'abord celle du vieillissement de la population nippone, et la nécessité de proposer des engins adaptés aux déplacements de proximité, le fauteuil roulant est apparu comme une réponse naturelle. Restait à la caréner autrement. Chose faîte aujourd'hui par la plupart des constructeurs (Honda, Suzuki ...)
Aujourd'hui son utilisation est tellement banalisé que certains quartiers de Kyoto ou de Takayama bénéficient d'équipements pour faciliter leur circulation et leur parking.
L'autre influence est celle des mangas qui ont banalisé dès les années 70 avec Mazinger et Goldorak, le robot comme véhicule à part entière. Dans cette lignée, on ne peut que remarquer la très grande cohérence des propositions de Toyota qui en 2005 présentait ses "scienfictionesques" concepts I-Foot et et I-Unit qui aboutissent aujourd'hui à l' I-Real ou à l' I-Swing (voir photo). Le point fort de ce constructeur est d'avoir réussi à totalement "démédicaliser" le fauteuil roulant pour en faire un moyen de transport branché ... et désirable par toutes les générations.
L'autre influence est celle des mangas qui ont banalisé dès les années 70 avec Mazinger et Goldorak, le robot comme véhicule à part entière. Dans cette lignée, on ne peut que remarquer la très grande cohérence des propositions de Toyota qui en 2005 présentait ses "scienfictionesques" concepts I-Foot et et I-Unit qui aboutissent aujourd'hui à l' I-Real ou à l' I-Swing (voir photo). Le point fort de ce constructeur est d'avoir réussi à totalement "démédicaliser" le fauteuil roulant pour en faire un moyen de transport branché ... et désirable par toutes les générations.
De façon plus large, on peut se demander si les constructeurs japonais n'ont pas inventé là un nouveau type d'engin qui va apporter enfin une solution satisfaisante à l'ambition de créer des offres de voitures en libre service.
En effet, si aujourd'hui, certaines municipalités imaginent développer ce type de service de voiture en libre accés à l'image des Vélib parisiens, aucun grand constructeur traditionnel n'est capable de proposer un tout petit véhicule électrique adapté à ce type d'offre avec les véhicules directement installés sur la voirie.
De façon encore plus prospective, Suzuki imagine aujourd'hui avec son concept PiXY (voir photo) un véhicule pouvant transporter sur une longue distance deux "fauteuils roulants", ceux-ci pouvant ensuite retrouver leur autonomie dans les zones urbaines centrales qui seront de plus en plus interdites aux voitures.
En effet, si aujourd'hui, certaines municipalités imaginent développer ce type de service de voiture en libre accés à l'image des Vélib parisiens, aucun grand constructeur traditionnel n'est capable de proposer un tout petit véhicule électrique adapté à ce type d'offre avec les véhicules directement installés sur la voirie.
De façon encore plus prospective, Suzuki imagine aujourd'hui avec son concept PiXY (voir photo) un véhicule pouvant transporter sur une longue distance deux "fauteuils roulants", ceux-ci pouvant ensuite retrouver leur autonomie dans les zones urbaines centrales qui seront de plus en plus interdites aux voitures.
Il s'esquisse là des pistes qui montrent combien la voiture dans sa forme actuelle est probablemnt en fin de vie, et que l'enjeu des années à venir va être d'inventer de nouveaux type de véhicule qui se situeront entre le scooter et la voiture. Un segment aujourd'hui totalement vide et qui pourtant va devenir dans les prochaines années un enjeu industriel et serviciel majeur.
Deux questions - un peu cruelles - pour finir :
Deux questions - un peu cruelles - pour finir :
- Où sont les projets des constructeurs français sur ce sujet ?




.PNG)